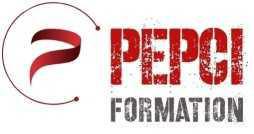Technicien dans une centrale photovoltaïque, compagnon installant une voie de chemin de fer ou reporter en zone de conflit, telle est la diversité des métiers qui constitue le groupe Bouygues. Présent dans 80 pays et regroupant plus de 200 000 collaborateurs, la multinationale déploie des actions via ses 2 500 préventeurs pour tenter de préserver la santé et la sécurité de tous, quels que soient leurs terrains d’intervention. L’objectif du groupe est de « mettre la prévention des risques au cœur des métiers » et « d’appliquer partout la culture sécurité », assure Cécile Roman, coordinatrice santé sécurité au travail (SST) chez Bouygues, lors du salon Preventica Paris.
Bien que les taux de fréquence et de gravité du groupe ne cessent de diminuer depuis 10 ans, « il y a encore des accidents du travail graves et mortels chaque année », déplore-t-elle, ce qui nécessite « des efforts à mener en permanence ». Bouygues entend ainsi « se projeter et réfléchir sous l’angle des droits humains sur la chaîne de valeur, dont le droit à la santé et à la sécurité au travail » (conditions de travail, conditions d’hébergement, etc.) pour tous les acteurs, notamment « les intérimaires, les sous-traitants, les fournisseurs ».
Au sein de la filiale Colas qui réalise la construction et la maintenance des infrastructures de transports et qui gère des carrières et des usines de production d’enrobés, la maîtrise des risques majeurs fait partie des priorités en termes de SST : collision engin/piéton, sécurité routière, consignation électrique, etc. Colas souhaite « ancrer la culture sécurité, du top management au compagnon, et avoir le même niveau de sécurité pour les intérimaires et les sous-traitants », insiste Carine Piquet, directrice prévention, santé, sécurité.
Pour cela, la filiale a lancé, depuis 2019 en France et 2021 à l’international, le programme « One Colas Safety » qui « vise à l’autonomie de l’ensemble de la ligne hiérarchique pour identifier les situations à risques et amener les collaborateurs à avoir une prise de conscience ». À travers une « formation "voir et dire" », les managers bénéficient d’un « coaching sur place pour les accompagner sur ces pratiques, avec des routines d’encadrement, des comités de pilotage mensuels dans les agences et un suivi des actions », précise-t-elle.
Du côté d’Equans, filiale de Bouygues qui intervient dans la mécanique, la robotique, le digital, l’électricité, la protection incendie, la réfrigération, les solutions CVC (chauffage, ventilation et climatisation) ou encore le facility management (services généraux), la priorité a également été donnée au fait « d’embarquer toute la ligne hiérarchique et notamment le top niveau », met en avant Carine Le Callonnec, directrice santé et sécurité.
« Trois fois par an, une journée complète est menée pour balayer les enjeux santé sécurité avec la direction », explique-t-elle. Lors de ces événements, « des décisions d’actions sont prises », comme celle concernant « les 12 règles d’or pour pallier les risques majeurs tels que celui de chute qui est très prégnant ». Ces décisions émanent des réponses aux questionnaires terrains réalisés auprès des collaborateurs d’Equans (feedbacks) et des managers (styles de leadership). Ces questionnaires visent à analyser la perception de la SST chez Equans par les salariés et par la ligne managériale. S’il existe un écart notable entre les deux, Equans met en place des actions pour aligner les deux visions.
Sur les chantiers de la filiale Colas, l’intelligence artificielle (IA) « permet de détecter des situations dangereuses », signale Carine Piquet. En matière de prédictivité, « ce ne sont encore que les prémisses » qui se traduisent par « un projet groupe de développement pour l’analyse et la prédiction avec des caméras ».
Pour Carine Le Callonnec d’Equans, « le métier de préventeur est en évolution » et doit intégrer « les outils d’IA qui l’aident à aller plus vite » grâce à « la collecte de datas et les caméras intelligentes sur les chantiers qui détectent les anomalies et font des comptes-rendus ».
Autre action développée par Colas et primée à l’occasion du salon Preventica, celle du « Plan santé et prévention des compagnons Colas Rail ». Cette démarche de prévention, engagée en 2023, a pour but de toucher les populations du terrain dont les compagnons de Colas Rail qui « réalisent leurs activités la nuit et sont souvent en grand déplacement à la semaine à l’autre bout de la France ».
Le premier axe de ce plan consiste à « informer et communiquer sur le sommeil, la nutrition et les addictions ». Un partenariat avec « Pro BTP » est mis en place pour réaliser les formations. Une action avec les équipes en charge du planning est aussi instaurée pour faire comprendre que « les changements d’organisation au dernier moment ont des impacts sur les compagnons ».
Le second axe se résume à « amener au pied du chantier des professionnels de santé car les compagnons sont souvent loin de chez eux et ont peu de temps pour les voir ». Ces examens peuvent permettre de détecter « du diabète, du cholestérol ou de l’hypertension » et « d’orienter certains salariés vers des examens complémentaires ». Une démarche pour laquelle « 70 à 80 % des compagnons sont volontaires », se félicite Carine Piquet.
Du côté d'Equans, Carine Le Callonnec rappelle « qu’il n’y a pas de sécurité s’il n’y a pas une bonne santé ». Selon elle, « la santé et la sécurité vont toutes les deux ensemble et ne font qu’un ». Sur le sujet de la préservation de la santé des salariés, Equans a déterminé quatre piliers principaux à prendre en compte dans la démarche de prévention :
- « l’exposition aux produits chimiques, à l’amiante, au plomb, etc. ;
- l’ergonomie, l’adaptation du travail au corps et à l’être humain ;
- la prévention des accidents cardiaques ;
- la santé mentale ».
Dans la filiale Bouygues Construction, implantée sur les chantiers de bâtiment et les activités de travaux publics et de génie civil, « les enjeux SST sont les mêmes que chez Colas », indique Bruno Magnin, directeur santé et sécurité. Afin de « diminuer les accidents graves et de tendre vers le zéro », la filiale Bouygues Construction a défini ce qu’était un accident grave : « Un accident avec une incapacité permanente ou avec une hospitalisation de plus de 48 heures ». Cette définition s’applique désormais pour tous les métiers de Bouygues Construction et permet d’avancer avec une vision collective.
Avec près des deux tiers de ses activités réalisés hors France et un million de personnes sur les chantiers Bouygues Construction en 2024 (sous-traitants, intérimaires, etc.), la filiale fait face à des enjeux liés à l’internationalisation. Par exemple, pour les accidents graves, « avant on pilotait avec des indicateurs qui n’avaient pas tellement de sens en fonction des pays car pour un même accident dans certains pays on a 3 mois d’arrêt et dans d’autres on reprend le lendemain », note Bruno Magnin.
Pour « embarquer tous les collaborateurs et faire d’eux des ambassadeurs de la culture sécurité au quotidien », Bouygues Construction déploie, depuis 2018, des « programmes de safety leadership » et mise sur des « efforts de formation quand les gens arrivent dans l’entreprise pour la première fois », fait-il remarquer.
Au niveau international, la filiale met actuellement l’accent sur trois actions :
- « des savoir-faire d’ergonomie, pour que les gens prennent moins de raccourcis lors de tâches pénibles (mise en place depuis 15 ans en France) ;
- des démarches de prévention lors des visites médicales, car ce n’est pas obligatoire dans tous les pays de la filiale ;
- des standards très exigeants en matière de silice ou de poussières de bois par exemple, puisque les règlementations sont différentes selon les pays ».
Dernière filiale du groupe Bouygues présente lors de Preventica Paris mais avec des activités différentes des trois précédentes filiales évoquées : TF1. Intégrée au groupe depuis la fin des années 1980, TF1 regroupe 370 métiers (production audiovisuelle, métiers du digital, graphistes, tournages en extérieur, etc.).
Pour Valérie Grison, responsable QVCT (qualité de vie et des conditions de travail) et protection sociale de la filiale, « l’invasion en Ukraine a été un tournant dans la politique de prévention de TF1 ». Elle précise « qu’il faut être volontaire pour partir faire du journalisme en zone de guerre ». Avant d’être envoyés en zones à risques, les journalistes bénéficient :
- « d’un stage d’une semaine avec l’armée à Collioure, où on leur apprend à ramper avec la caméra, à être auprès des militaires sans les déranger ;
- d’un apprentissage des connaissances de base pour faire du journalisme en zone de guerre comme le fait de ne pas parler à un correspondant local de certains sujets ;
- d’un parcours à suivre avant de partir comprenant un brief avec la direction de la sureté, un brief avec le manager, un brief avec le service de santé au travail, la remise d’une trousse de secours (garrot) et le passage par le magasin où leur sont remis un casque et un gilet par balle de 12 kg ».
Sur place, les journalistes de TF1 sont accompagnés d’un « fixeur » qui connaît les zones et les guides. Lors du retour en France, ils doivent « débriefer avec la direction de la sûreté, le manager et un médecin spécialiste en psycho traumatismes ».
► Lire aussi : |
|---|